 |
| Eduard Hildebrandt - Vue du Caire |
« Plus loin, au
sud-est, Le Caire s’appuyait de toute sa splendeur contre des collines arides. Nous
marchâmes à travers champs, auprès de nombreux campements, et parvînmes au pied
des remparts. On entra dans la cité par la porte fortifiée de Bab al-Futuh. Les
deux tours rondes enserrant la porte me faisaient penser aux deux belles joues
d’une grand-mère dodue ; je me coulai en baissant la tête dans son baiser
vorace. Mes pieds foulaient une terre jaune, jonchée de détritus, puis
j’observai, ébahi, certaines hautes maisons qui se chargeaient des fins décors
en bois des moucharabiehs. Nous traversâmes toute la ville. Chaque fois que
l’homme richement vêtu se retournait vers moi, je peignais sur mon visage,
malgré les bousculades de la foule étrangère, un air de confiance et de
dévouement. "Chante-moi encore une chanson !", fit-il. Et je
chantonnai un des airs des bateleurs du Nil.
"Ô ! Vive lumière du jour naissant !
sur les eaux du
Nil j’ai vu paraître
Un visage neuf, adolescent,
un corps nubile
que je veux connaître."
 |
| David Roberts - à l'entrée d'une mosquée |
« Il figea sur ses
lèvres un sourire de contentement et se mit à siffloter en chœur avec mon chant quelques
rengaines joyeuses. Il m’entraîna ainsi jusqu’au pied de la citadelle dont il
me fit longuement le détail, puis nous revînmes sur nos pas dans le
souk-aux-armes jusqu’au palais de son maître : le prince Al-Razzaz. Nous nous
introduisîmes dans la grande bâtisse par une porte dérobée. De là, nous fûmes
conduits jusqu’au quartier des eunuques, auprès du harem du prince. Le
négociant signa un billet qu’il donna à un vieil eunuque, puis il me flatta la
tête, me dit que j’étais un gentil garçon, soupira, me regarda encore une fois
comme à regret et me laissa au milieu de ces inconnus. Il faisait sombre dans
ce coin du palais et je ne parvenais pas bien à m’habituer à l’obscurité, après
la longue marche au soleil. Tandis que le vieil homme déchiffrait le billet du
négociant, un adolescent noir surgit des ténèbres. Il me prit par la main et
s’excita tout en essayant de me demander quelque chose que je ne parvenais pas
à comprendre. C’était toute une représentation bizarre où il me montrait ses
fesses et son sexe mutilé en poussant des grognements animaux. Des années plus
tard, avec l’expérience, je compris ce qui tracassait alors ce garçon : il
voulait savoir si j’avais été abusé, violé par de précédents maîtres. Dieu soit
loué de m’avoir préservé de ce genre d’affaires… Ghalib, le jeune garçon
anxieux, fut corrigé d’une volée de gifles par le vieil eunuque qui avait
achevé sa lecture du billet. Le vieil homme me prit la main. Et me voilà donc dans
mon nouveau logis ! Il me conduisit au bain, examina soigneusement ma
cicatrice, fit une moue sinistre. Puis on me donna quelques affaires et il
m’attribua un lit dans sa chambre. Il était le chef en second des eunuques. Il s’appelait
Hanine, élevé à Damas. Sa peau était d’un brun olivâtre et ses rides profondes
s’inscrivaient dans un visage épais, aimable et doux. Il était très pieux et
très instruit. Il fut mon premier enseignant. Hanine avait jadis distrait les
esprits féminins les plus raffinés, mais sa vieillesse le rendait moins patient
et moins aimable, aussi ses services n’avaient plus l’attrait de jadis. Je fus
pour lui, à ce qu’il m’en a dit sur son lit de mort, une source de renouveau et
de joie par la grâce de ma curiosité : Hanine m’apprit la langue et
l’écriture arabe, le calcul et les bonnes manières… Toutes choses qui font une
bonne instruction. Je ne regimbai jamais et il eut très peu d’occasions de me
faire goûter du feu de sa main. Et, de tous les bienfaits que m’apporta le
vieux Hanine, je lui dois surtout le plaisir des contes. Il féconda mon
imagination d’enfant ; échauffa mon plaisir du langage et des situations
inhabituelles… Quand, après toutes les douleurs et les efforts du service, il
ouvrait sa bouche dans le noir de notre chambre et que sa voix tremblante
chuchotait des histoires pleines de magie et de récompenses délicieuses, je
ressentais des frissons d’un plaisir inexprimable.
« En cachette, je
l’appelais grand-père. En cachette, Hanine me couvrait le front de baisers.
« Dès mes premiers
mois au palais du prince Al-Razzaz, un imam se chargea de ma conversion. Pendant
les années suivantes, ce fut donc l’imam Ibrahim qui vint régulièrement nous
faire la récitation. Cet homme simple et grave était en charge des eunuques et
des esclaves. Il nous apprenait la morale du Coran, mais il avait la
particularité de vouloir encourager la foi par des chants religieux. Sous la
direction d’Ibrahim, je découvris ainsi une des raisons qui m’avaient valu les
égards de mes propriétaires successifs : ma voix. Elle s’écoulait de moi
comme l’eau de ma rivière d’enfance, fluide entre les rochers, chargée d’un
limon d’argile tendre. Ma voix. Un flot de sons liquides circulait entre les
piliers et retournait remplir mon cœur de son eau apaisante… L’imam me
distingua entre tous et compara ce qui sortait de moi aux plus gracieux dons
d’Allah. Tout le monde fut heureux qu’Il prouve sa miséricorde et sa protection
par l’enchantement de ma voix. L’austère imam s’enthousiasma et rédigea même
une fatwa : au nom d’Allah le
Très-Haut, le miséricordieux, l’Unique, l’Inégalable et de son prophète
Mahomet, le cavalier de Dieu, le messager, l’annonciateur, celui qui abîmerait
mon chant, celui qui serait responsable de son altération se verrait trois fois
maudit et sa langue brûlerait dans le feu divin. Si cette fatwa m’épargna
bien des préjudices physiques de la part des eunuques les plus pervers, notamment
Ghalib le fou, elle fut aussi la cause d’une surveillance de chaque instant sur
ma personne : mon régime alimentaire, mes sorties, la température de mon
bain et de mon lit, la durée quotidienne de mes chants, mon temps de parole journalier
autorisé… Pendant quelques années, toute ma vie s’organisa selon des règles
absolues.
— Tu n’étais donc pas un
esclave comme les autres. Tu étais protégé, commenta Cromar.
— Ce n’est pas exact. La
fatwa d’Ibrahim, l’imam aux esclaves, ne portait pas jusqu’aux oreilles des
vrais maîtres. Dans le quartier des eunuques et auprès des femmes esclaves, je
jouissais d’un statut privilégié, mais s’il advenait que je déplus à la famille
Al-Razzaz, ils pouvaient me faire battre durement. En conséquence de quoi, je demeurais
vigilant.
— Ah oui, cela t’est
arrivé ? Des coups de fouet ?
— Eh bien… un épisode
mémorable faillit me coûter la peau. Il advint, tandis que l’armée française avait
pris pied dans notre monde, que les autorités imposèrent un éclairage public,
la nuit, à la charge des habitants. Chaque maison devait assurer la lumière
dans la rue, à raison d’une lampe par maison. Mais la nôtre équivalait à
plusieurs dizaines de maisons, aussi devions-nous assurer une grande quantité
d’éclairage. Or, par une nuit d’hiver très froide et humide, la confusion se
fit, car c’était à moi cette nuit-là que revenait la corvée, et certains des
esclaves me déconseillèrent de sortir allumer les lampes car je risquais de
prendre un rhume et d’abîmer cette chère voix faite pour les louanges du
Très-Haut. Il y eut une dispute compliquée dans nos quartiers ; en résulta
toute une rue enténébrée pour la nuit et, le lendemain, le chef du district
vint présenter à mes maîtres une amende de cent riyals pour négligence
aggravée, car ce n’était certes pas la première fois que l’étourderie de nos
gens s’affichait par des coupables ténèbres. Alors, le prince Amir accompagné
de son premier fils Ahmad descendit dans les dépendances des esclaves et donna une
grande démonstration de son courroux. Il fit battre les chefs des eunuques,
dont mon cher Hanine, qui fut fouetté de dix coups. Puis il se saisit de moi, le vrai coupable, suivi par son fils qui
battait des mains et par deux femmes esclaves qui imploraient sa clémence à mon
endroit. Quand nous fûmes parvenus dans une vaste arrière-cour, je vis une cage
aux barreaux d’or, émaillés, rongés. Dans cette cage se trouvait un grand chien
de chasse paré de soie grège et de brocart. Le prince Amir flatta sa longue
tête gémissante et glissa une friandise entre ses babines retroussées. Quant à
moi, j’étais dans ce qu’on nomme d’ordinaire l’adolescence ; j’avais beaucoup
grandi en un an, mais le lévrier paraissait si imposant ! Je faisais ce
que je pouvais pour ne pas montrer ma peur.
 |
| Jean-Léon Gérôme - un arabe et ses chiens |
« On me dénuda, à
l’exception de mon sous-vêtement. Le prince Amir me fit poster sur une dalle
noire, au milieu de la cour de terre battue, où je devais me tenir immobile —
je tremblais dans le matin glacial —, puis il entra dans la cage où le sloughi geignait
et m’interpelait de plus en plus fort. Amir ôta la parure du chien dont les
flancs nus frémirent d’excitation. Ses muscles se contractaient à son garrot et
sur sa croupe comme des serpents. Il pointa son museau vers moi et glapit. "Cours,
maintenant ! ", s’écria Ahmad, le fils du prince, et je ne sais
s’il s’adressait à moi ou au chien. Le prince lâcha le collier du sloughi ;
l’animal se détendit comme une vipère. Je faillis flancher. Si je lui tournais
le dos, il serait sur moi en quelques bonds et me hacherait les mollets. Dans
un tourbillon de poussière, il vint à moi à une vitesse vertigineuse — je ne
voyais pas ses pattes toucher le sol. Frissonnant
d’horreur, j’aplatis les mains contre mon visage, comme me l’avait enseigné Ibrahim, fermai les
yeux et entonnai un chant de grâces. Je sentis le chien filer tout contre moi
avec un joyeux claquement de mâchoires. Il repassa par dessous mon coude, puis je
le sentis tournoyer et cavaler dans mon dos. Une nouvelle cavalcade interrompit
un instant ma complainte. Je repris mon chant. Le chien, alors, se planta devant
moi et piétina un peu ; son souffle haletant, chaud, effleurait, captivait
mon ventre nu. Il fit soudain une volte brutale et décampa plus loin pour
prendre un nouvel élan. Les yeux clos, de plus en plus calme, je ne ressentais
plus le froid et presque plus la peur, je me concentrai sur mon chant et la
réverbération de ma voix contre les murs de la cour. Enfin, une main se posa
sur ma tête, et la voix du prince Amir demanda : "Comment
t’appelles-tu, jeune esclave ? — J’ai pour nom Wadih, Ô, mon seigneur,
dis-je en ouvrant les yeux. — Wadih, je suis heureux d’avoir perdu cent
riyals aujourd’hui, et j’en perdrais volontiers cent de plus pour m’assurer de
ce miracle. J’avais entendu les esclaves parler de tes dons mais, j’en appelle
à Dieu, tu as aussi le sang-froid d’un vrai croyant. Si tu n’avais pas cette
peau si noire, je jurerais qu’Il te protège. À tout le moins, Il t’a donné la
voix d’un ange divin."
« Mon attention
soulagée se porta derrière le prince, où je pus constater que le sloughi était
retourné par lui-même dans sa cage. Ahmad, le fils d’Amir, semblait déçu. Son
père lui demanda de venir près de moi et de me passer sur les épaules sa veste
matelassée. Ahmad eut un geste d’humeur, mais son père lui demanda ironiquement
s’il lui était égal de déplaire à Allah ; alors, l’adolescent daigna me
regarder en face. Je levai les yeux et remarquai un changement dans son visage
— un calme, un apaisement. Il me passa sur les épaules sa veste, un peu large
pour moi. Cette scène incroyable ressemblait tant aux contes de mon cher vieux
Hanine ! Je bafouillais des remerciements et les recommandais au ciel pour
leurs grâces.
— Bonne mère !,
s’étrangla Cromar. Tu leur vouais le paradis alors qu’ils avaient cherché à te
faire mettre en pièces par un chien !
— Logique
d’esclave !, s’exclama Wadih. On ne remettait jamais en question les
décisions de nos maîtres. Leurs coutumes, leurs règles, leur civilisation, tout
cela m’était surnaturel. Je me sentais si futile face à eux ! Les contes
de mon cher vieux Hanine m’apportaient la confirmation d’un ordre du monde
immuable où les bons obtenaient les richesses et les mauvais étaient punis.
Ainsi, de nombreux récits mettaient en scène la lubricité des noirs, leur
violence sexuelle ; le vieux Hanine me certifiait, sur la foi de ces
contes, que notre castration était une forme de bienfait, car elle nous
prémunissait de ce grave péché — "kabira",
me disait Hanine en écarquillant les yeux.
— La castration, un
bienfait, elle est fumeuse, celle-là… Ton vieux Hanine tirait bel et bien son
sens commun des contes… Castrer des enfants !... »
Jean Cromar se mit à
arpenter le quai au pied du phare comme un fauve. Il fulminait.
« Dans nos contes,
il n’était pas rare que des nègres forçassent la vertu des petites filles.
Cette idée, pour moi qui fus bientôt introduit dans l’intimité des filles du
prince, m’était intolérable ! J’étais soulagé de ne pas avoir la lubricité
qui pousse à abuser des enfants, argua Wadih.
— Mais enfin !
Qu’est-ce que cela veut dire ! Quelles idées t’avait-on mises dans la
tête !, s’écria l’aubergiste, hors de lui. Comment présumer d’une chose
pareille, et sur ces croyances hasardeuses, justifier la castration ?!
— Cette idée révoltait
autant monsieur le Baron que vous. C’était un chrétien et un voltairien, et il prétendait
que ces grandes philosophies ne permettraient nullement qu’on infligeât cela à
un être humain. Mais enfin, mettez-vous à notre place… c’était une
satisfaction, un réconfort, de penser que notre condition d’eunuque nous
élevait au-dessus de certaines considérations. Il fallait, d’une façon ou d’une
autre, satisfaire notre orgueil d’humiliés.
— Et donc… Est-il vrai
que vous n’avez pas de désir sexuel ?, interrogea Jean.
— Savez-vous que beaucoup
d’eunuques sont très gras ?, répartit Wadih.
— Je l’ignorais.
Vous-même ne me semblez pas correspondre à cette description.
— Je désire, j’ai de
l’appétit, comme chacun ! Dans les rets de l’esclavage, sans que j’en
fusse exactement conscient, mon corps se mourait de soif, réclamait de la
volupté. »
Jean Cromar eut une
hésitation. Il retenait sa curiosité par peur de blesser son ami. Il reprit,
d’un ton neutre :
« Et comment
avez-vous été traité, après cette épreuve du sloughi ?
— Ma récompense fut un
des plus beaux événements de mon existence : après l’examen soigneux de
mes organes génitaux et de ma conduite en quatre ans de servitude, on m’offrit
d’accompagner l’éducation musicale des filles du prince… Amir avait de
nombreuses filles et davantage de garçons. Ses filles préférées se nommaient
Alma, Sonia, Radia et Amira. Dans la maisonnée, on les appelait le quatuor majestueux. Alma, la première
de ses filles, avait quinze ans révolus ; Amira en avait neuf. Alma me
semblait une jeune femme à l’autorité merveilleuse.
Quand elle jouait du luth
avec Imen, notre maître de musique, une vieille dame mince et osseuse comme un
chat, c’était une pluie de notes savamment organisées, dont les agencements
entremêlés ouvraient des portes mentales nouvelles, tissaient des ponts pour le
tajwīd, un chant religieux, que nous
exécutions, tour à tour, avec ses sœurs cadettes. Alma elle-même possédait un
timbre naturel éblouissant. Nos exercices se déroulaient le matin. Comme
j’étais pressé de les rejoindre ! Je devais promptement exécuter mes
rituels d’ablutions et de prière, accomplir de rudes travaux domestiques, avant
de pouvoir gagner la salle du harem dévolue à l’étude musicale. Nous nous
asseyions sur des coussins autour de l’osseuse Imen qui nous fixait de ses yeux
profonds. Elle pouvait passer toute une leçon à décrire une voix, un timbre — taa’bé — ce qu’il fallait aller chercher
au fond de soi comme un trésor englouti, le commandement qui s’imposait si l’on
trouvait ce trésor : le tirer du puits de la gorge, syllabe après syllabe,
pouvoir ressentir sa forme, son émotion, et l’accompagner en modulant la voix
pour ne pas rompre le fil accroché à ce trésor ; puis, une fois tiré de
son fourreau, présenter ce trésor de voix à la pièce, à l’auditoire, distribuer
le sawt, le timbre éclos, à chacun
des auditeurs, féconder leurs oreilles, pour qu’ils témoignent avec nous de la
grâce du Très-Haut. L’étude s’achevait sur un chant voluptueux, à plusieurs
voix, qui prenait possession de moi et m’envoyait, avec mes princesses, sur un
tapis volant sonore, haut par-dessus les toits du Caire, entre les
seins-coupoles des mosquées et les lances farouches des minarets. J’avais pour
habitude de me frotter les cuisses avec les paumes des mains pour augmenter mon
plaisir. Sonia et Amira finirent par m’imiter et il me semble que Sonia y prit
un plaisir trop sensible ; Imen récusa donc cette pratique et, à part, me
réprimanda. »
 |
| J-D-A. Ingres - L'odalisque et l'esclave |
L’aubergiste reprit la
cruche de vin et en tira une goulée affectueuse.
« Ces histoires de
filles émues par la musique, cette intimité de harem me plaît ! C’est
drôlement excitant…
— J’adorais mes leçons de musique. Par ma
douceur et ma joie, par ma facilité à m’accorder aux apprentissages, j’entrais inévitablement
dans les grâces des filles du prince. Elles m’accueillaient, elles
m’acceptaient. Nous faisions des progrès tangibles. De sorte qu’il arrivait
maintenant que nous quittions la salle de musique et l’accompagnement des
oiseaux afin de donner nos tours de chant dans la salle de réception, pour le
prince Amir et ses invités.
Alma accomplissait, au luth, une ouverture simple
et lumineuse, une mélodie qui donnait le ton. Elle chantait seule, un chant
doux, quelques paroles touchantes, une supplique, et nous y mêlions soudain les rythmes complexes
de nos percussions. Imen intercalait dans la mélodie d’Alma, les trilles du
second luth, qui étaient des averses de lumière, un chatoiement délicieux. Mon
étrange voix reprenait, en écho, la complainte d’Alma. Je mimais le doux émoi
féminin, chacune des variations de la voix d’Alma, mais c’était si calme et
irréel qu’il n’y avait rien de grivois, aucune ironie. C’était, un pied dans
l’empreinte du pied précédent, une réponse à un appel, sur le même chemin de
souffrance, une promesse de compassion. Enfin, chacune des sœurs reprenait le
thème et proposait son interprétation. À ce moment de la transe, une esclave se
levait et effectuait une danse, les yeux mi-clos, le corps traversé par la
musique, conduite comme une marionnette, secouée comme un hochet. »
 |
| John Lewis - Repas au Caire |
Sous l’attention
émerveillée de l’aubergiste, par-dessus le son du ressac, Wadih, de ses mains
en cuiller, composa un rythme alternant trois temps et quatre temps,
irrégulièrement, mais selon une fluidité naturelle. Chaque mouvement rythmique
complétait l’autre, soulageait l’ensemble d’une apparence de complexité,
résolvait la combinaison comme une évidence. Il chanta en Arabe :
« Le soleil et la
lune témoignent de la grandeur d'Allah.
Louanges à Allah qui
nous distribue ses bienfaits, chaque jour et chaque nuit,
Le
jour éteint enfin son feu, sa douloureuse agitation.
La
nuit sera propice aux amours des princes,
Où
est mon prince ?
Dans la bougie aussi, dans
l’intimité du couple, dans ma solitude, l'œil bienveillant d'Allah. »
Les pêcheurs sur le parapet applaudirent, gentiment moqueurs. L’aubergiste,
lui, avait eu des frissons et quelques petites larmes de trouble. Il
bredouilla :
« Ô, compère… C’est beau.
— Merci. Ce sera toujours une terrible frustration de chanter sans mes
chères maîtresses…
— J’ai l’impression que
j’ai ressenti cette douleur dans ton chant.
— Oui, c’est tout à fait possible…, souffla Wadih, soudain ému. Enfin,
quand les trois sœurs d’Alma daignaient achever la transe, les percussions giflaient
l’air une dernière fois, puis Alma et moi proposions une manière d’épilogue, à
deux voix — le chant se faisait plus précis, apaisé, des notes à l’unisson,
comme si le bonheur était possible. »
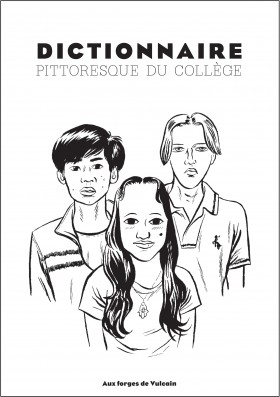


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire