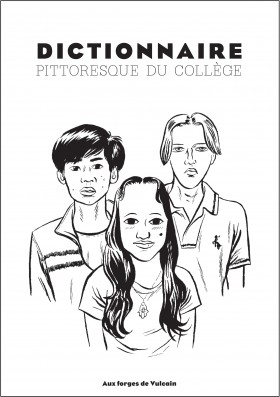Le blanc des yeux de
Wadih s’injectait d’un peu de sang. Il se racla la gorge et affermit sa voix.
« Nos prouesses musicales occasionnaient des soupirs ravis et des clameurs enthousiastes. Ce fut
d’ailleurs lors de l’un de ces concerts que je croisai pour la première fois de
ma vie le regard admiratif du baron d’Adaoult. Le prince Amir l’avait convié
avec des officiers français à partager une collation et un concert. Le snobisme
des officiers céda face à l’enthousiasme éloquent du baron et notre longue représentation
se conclut sur des vivats et des bravos.
Ravies de nos succès répétés, les filles du prince furent bientôt très
attachées à moi. Elles prièrent leur père de bien vouloir me donner tout entier
à elles. Il refusa dans un premier temps mais les privations, les violences,
sous l’occupation française, étaient rudes — un oncle était mort en cherchant à
s’enfuir avec son or, deux demi-sœurs avaient contracté une terrible maladie et
avaient trépassé, plusieurs cousins avaient été exécutés sur l’ordre des
autorités — aussi Amir sentit qu’il devait une consolation au quatuor majestueux. J’avais donc maintenant
deux logis : une cellule dans le logement des eunuques et une petite alcôve,
à proximité du quatuor.
— Dans ces conditions, tu
es fatalement tombé amoureux de tes chères maîtresses…, souligna Jean.
— Certes oui, à ma façon…
Mais Alma et Amira étaient au moins autant attachées à moi.
— Alma, c’était la sœur
aînée…
— Oui.
— Et Amira, la cadette…
— En effet.
— Et les autres, elles
t’aimaient ?
— Sonia avait mon âge et
elle aimait dire des choses blessantes sur les nègres. Je ne sais pas si elle
le faisait vraiment exprès. Elle cherchait à me faire pleurer devant les
autres, à paraître excessivement cruelle avec moi en société ou devant ses
sœurs.
— Oui, je dirais que tu
l’attirais mais qu’elle veillait à son orgueil…
— Je l’aimais bien,
malgré ses taquineries. C’était la seule du quatuor à être grasse. Sa peau
était la plus claire, et les quelques fois où elle me prit dans ses bras pour
me couvrir de baisers, nous rîmes de bon cœur du contraste de nos corps. Elle
disait alors qu’il ne fallait pas qu’elle y prenne du plaisir, car cela
finirait mal : elle irait, sur cette pente, copuler avec des singes… Quant
à moi, je trouvais sa peau d’une douceur à se pâmer et le plaisir suave de ses
caresses me prévenait contre sa méchanceté feinte.
— Et Radia ?
 |
| Théodore Chassériau - Harem |
— Radia avait la
souplesse du roseau. Avec l’âge, elle devint une jeune fille sensuelle dont la
beauté faisait se troubler l’alentour. Quand elle se tenait en quelque lieu,
plus rien n’existait hormis sa beauté étourdissante. Si elle découvrait son
pied et sa cheville, le temps se suspendait ; si elle remontait le tissu
au mollet, les cœurs se déchiraient.
— Comme tu parles bien
des femmes, Wadih !, s’enthousiasma l’aubergiste.
— À nous cinq, nous
étions un corps oisif et languissant ; j’étais pour mes chères maîtresses
un flou rassurant, une créature sans identité masculine, presque hors du temps.
Ma présence unissait les sœurs, les rendait bonnes les unes aux autres. Quand
nous sortions du palais, en de rares incursions dans la ville, nous croisions
des soldats français, mal en point, ou bien des zélotes révoltés et
arrogants ; alors, le monde réapparaissait brutalement dans toute sa
hideur. Tous ces hommes étaient des rustres : ils pinçaient les eunuques
au bras, pour vérifier s’ils n’étaient pas mieux nourris qu’eux. Les français
et les cairotes se regardaient de travers. Les autorités soutiraient de lourds
impôts et les égyptiens le leur rendaient bien, jouaient du couteau dans les
ruelles obscures et laissaient, ici ou là, un soldat égorgé. Dans ces
circonstances, nous passions le moins de temps possible hors du palais.
 |
| Interlude musical au harem - Fabbio Fabbi |
« Le temps… Les
intervalles des jours raccourcissaient de plus en plus vite. Après le départ
des troupes françaises, sous le protectorat britannique à peine moins pénible, la
famille de mon maître tenta de redonner un peu de lustre à ses titres de noblesse
mamelouke dégradés. Amir obtint pour Alma un bon mariage avec un riche natif du
Caire. Avant la cérémonie, ma bonne Alma me tint dans mon alcôve des mots de
regret et d’amour qui, s’ils étaient parés des vertus sororales, n’en vibraient
pas moins d’une émotion profonde. Il en serait ainsi : nous ne pourrions
plus chanter tous ensemble ; nous aurions désormais de rares occasions de
l’écouter jouer du luth. Tandis que mon cœur vacillait de désespoir, celui de
Radia, ma troisième maîtresse, s’épanchait en rêves de mariages glorieux. Elle
me réveillait la nuit, tant son excitation était grande, pour me forcer à lui inventer
des contes, à lui décrire de fastueux mariages, des princes splendides et
cultivés, des femmes plus ravissantes que la lune elle-même. Cela me permit de
distraire mon chagrin. Hélas, quelques mauvaises langues au palais complotèrent
contre moi et ma vie de paresse au service des filles d’Amir. Certains membres
de la famille disaient qu’après le départ d’Alma, sans le soutien de son luth,
nous ne pouvions plus accomplir nos prouesses musicales. Pour ceux-là, j’étais
désormais inutile. Je regagnai dès lors mon logis sinistre du quartier des eunuques.
J’étais moins heureux, consolé quand mes chères maîtresses me mandaient pour la
leçon de musique ou pour se distraire d’un conte, mais l’essentiel me
manquait : je ne partageais plus leur vie comme avant. Je ressentais
douloureusement la frustration. Aux caresses et à l’amitié de mes princesses se
substituaient les obsessions vicieuses de Ghalib et d’un autre eunuque,
Azzedine, qui avait la particularité désagréable de pouvoir lever. Quand ces deux-là venaient me
déranger, la nuit, comme je regrettais mon merveilleux quatuor de filles !
— Mais tu étais pourtant
protégé par une fatwa, non ?, s’enquit Jean Cromar
— Mon retour dans les
logements des esclaves était vu comme une disgrâce…
— Et alors, cela a été de
mal en pis ?
— Quelque chose est
arrivé… La jeune Amira souffrait de ma mise à l’écart. Elle m’a écrit un billet
de gentillesses, sur le modèle d’un conte où des esclaves doivent faire l’éloge
des différentes couleurs de peau. Ses mots traçaient adroitement un parallèle
entre la couleur de ma peau et la douceur, le calme, la beauté mystérieuse de
la nuit. Amira écrivait que la voix sortait de mon corps comme un rayon de lune
surgissant dans la quiétude attentive d’une chambre nocturne, qu’à l’opposé le
soleil, les murs blancs du palais et les sourires les plus brillants étaient
vides, formaient pour elle un sépulcre blafard, le blanc était la couleur de
l’ennui, le papyrus vierge… Sa lettre était, vis-à-vis de la société du sérail,
un crime innocent et formidable ; elle me fit éclater en sanglots, me tira
de la jarre débouchée et me frappa d’une révélation inattendue. Je répondis
sagement à Amira, par des promesses de loyauté et des compliments sur son être
et sa nature. Ainsi, nous engageâmes une correspondance secrète qui dura huit
années. Nous échangions des mots de compliments ou de soutien, des considérations
sur le monde, des récits inventés ou des poèmes. Nous nous les transmettions en
personne, les cachions dans nos vêtements puis, après plusieurs lectures ponctuées
de soupirs, nous les faisions disparaître aux ordures. Il était plus difficile
pour moi que pour ma petite maîtresse d’écrire en cachette.
 |
| J-L Gerôme - Bains maures |
— Ah ! Mais c’était
terriblement dangereux pour vous deux !
— Bien sûr, nous
risquions notre vie. Mais d’un autre côté, il y avait l’ennui vertigineux du
harem, qui était un semblant de mort. Ces lettres nous ramenaient à la
vie. C’était un besoin vital. J’y réfléchissais longtemps pendant les activités
de la journée avant de calligraphier vite et sans soin. Amira me faisait des
reproches sur la saleté de mon écriture, mais s’enchantait de tout le reste. Au
fil des ans, elle me donnait davantage de raisons de louer sa beauté et sa
bonté. Sa sœur Radia connaissait nos échanges, mais elle y voyait un moyen de
se désennuyer par procuration. Amira et elle veillaient à maintenir Sonia dans
l’ignorance de ces péchés par le verbe, car elles avaient la certitude que
Sonia causerait un esclandre et nous précipiterait tous dans l’enfer par son
manque de discernement.
« Quant à moi, ces
lettres faisaient plus que me distraire, elles me galvanisaient, me donnaient le
courage de lutter contre les esprits mesquins et serviles des autres eunuques…
Je me sentais plus vivant et plus aimable et meilleur que tous ces faquins.
Eux, ils constataient, incrédules, mon incroyable fatuité, et, hormis mon chant
délicat, ils n’en comprenaient pas la cause. Il n’y avait guère que mon bon
Hanine pour me supporter. »
Wadih suspendit son
récit. Il observait la rade de Marseille. Le soleil barbotait entre les nuages
blancs. La mer était tâchée d’ombres et de lumière. Jean Cromar fit remarquer
au grand noir que la faim se faisait sentir.
« Midi, n’est-ce
pas ?! »
Son compagnon se massa
l’estomac et reconnut son appétit.
Jean se saisit de la
cruche de vin, vidée. Il engagea Wadih à le suivre et à manger dans son
auberge. L’eunuque remercia Jean pour l’invitation. Ils repassèrent derrière le
fort, regrimpèrent les remparts jusqu’à l’esplanade arborée de Sainte-Marie
Majeure. Puis ils se faufilèrent dans l’ombre fraîche d’une ruelle jusqu’à La Calamarette. L’auberge s’emplissait
de quelques habitués. Il y avait notamment le P’tit Denis, le grand et gros
Michel, Alain, le déplumé, Rémi et Mariette, un couple au teint tapis de peau tannée.
Pierrette, la
cuisinière, avait préparé des pieds
paquets. Une odeur rustique de tripes et de vin blanc baignait la salle.
À la table de Wadih et
Cromar, on mangea de bon appétit en évoquant le bon souvenir du vieux baron,
son élégance désuète, son goût des cultures étrangères, son désir insatiable
d’érudition savante…
Depuis leur chaise, les
clients arrondissaient les yeux en observant leur Cromar dévorer son repas en compagnie d’un noir.
« Vé, ce Jean
Cromar, c’est vraiment un original…
— Bé donc, où c’qu’il a
péché son compère ?
— La Méditerranée
a-t-elle rétréci comme une mare, qu’il s’est trouvé un copain
d’Afrique ? », disait-on, en substance, à une table de mufles.
L’aubergiste vit que
les regards de ses clients dérangeaient Wadih. Il lui proposa de reprendre
ailleurs le récit de sa vie. Il pria P’tit Denis de débarrasser les tables et
entraîna Wadih au-dehors, jusqu’aux remparts de l’anse de l’Ourse.
L’eunuque reprit alors,
le ventre plein, l’esprit bercé par les efforts de la digestion :
« Vraiment Cromar,
cela fait du bien de parler avec toi…
— Mais je t’en prie. Ton
histoire est tout à fait intéressante.
— Alors je veux avancer
encore dans le temps, si tu me permets… Il y eut d’autres
bouleversements : peu après la cession du pouvoir par les Britanniques aux
Ottomans, le vieux Hanine mourut. J’étais si malheureux d’avoir perdu le vieil
eunuque ! Ne plus entendre sa voix inquiète… Ne plus pouvoir suivre du
doigt les sillons de sa peau si douce ! Mon chagrin émut Amir et son fils
aîné Ahmad. Ils me convoquèrent pour me demander s’il y avait quelque chose qui
pourrait me consoler.
— Ah !
Formidable ! Et tu as demandé à vivre avec les filles !, rêva tout
haut l’aubergiste.
— Oh ! Par
Allah ! Seigneur, non ! Ce genre de requête ne pouvait pas émaner de
moi ! Le misérable eunuque… Non, je fis ce qu’on attend de l’esclave dans
ce cas. Je dis que rien ne pouvait mieux m’agréer que servir jusqu’à ma propre
mort leurs êtres augustes, qu’Allah le Tout-puissant veille sur eux…
— Ah oui…
— C’est ce qu’il convient
de dire, monsieur Cromar. Je dis cela, puis la phrase suivante : "si
vos grâces daignent m’accorder le droit de prier pour le prince Amir, son
valeureux fils Ahmad et pour certaines personnes de votre famille, je serai
l’esclave le plus heureux".
— Je ne te pensais pas
capable de tant de servilité.
— S’il vous plaît…
Laissez-moi préciser de quoi il retournait… Amir était un homme fin, il me
demanda si par "certaines personnes", je voulais parler de mes
maîtresses du quatuor majestueux. Je
pris la mine la plus humble et acquiesçai. C’était, à mon niveau d’esclave, dans
mon esprit exalté, comme si j’avais demandé à mon maître la main de mes quatre
adorables maîtresses. Amir eut une hésitation, mais son fils Ahmad n’avait pas
saisi la double entente de ma prosternation. Il prit la parole pour dire son
enchantement. Amir dévisagea un instant son fils, mais il ne voulut pas être en
reste et me confia une charge plus haute, dans l’organisation de sa maison, pour
récompenser ma loyauté.
— Je… Ce sont des
subtilités que je ne comprends pas…, commenta Jean.
— Comprenez :
dorénavant, je saisissais que les contes ne m’avaient pas seulement enseigné à
respecter l’ordre du monde, ils m’avaient également appris à déstabiliser
subtilement l’autorité de mon prince. Ainsi, par cette affectation de pieuse
obséquiosité, je l’avais forcé à m’autoriser ceci : dorénavant, mes
pensées pour ses filles ne concerneraient que Dieu et moi-même. Mon avancement
dans la hiérarchie était accessoire, c’était la façon du prince Amir de donner
le change, de ne pas montrer sa faiblesse.
— Un eunuque
révolutionnaire !, s’esclaffa Cromar.
— Ce n’est pas si rare,
et puis n’exagérons rien… Il y aurait toujours les limites de ce que ma piètre
condition d’eunuque pouvait offrir.
— Allez, dis-moi un poème
d’amour ! Tu dois en connaître ! Amira et toi, que vous
écriviez-vous, par exemple ?
— Je veux bien vous dire une
composition d’Amira. Un de mes poèmes préférés. Ce n’est pas le plus tendre, ce
n’est pas le plus gracieux. Mais il montre bien, il me semble, la force
d’esprit de cette princesse. J’ai pris soin de mémoriser, puis plus tard de
traduire, ses meilleurs poèmes. Dans celui-ci, la tendresse que me portait ma
chère maîtresse l’a menée à une indignation prodigieuse contre mon état. Elle
m’écrivait ainsi :
L’ombre sur ton corps est profonde comme l’ombre
Rafraîchie des
galeries de la mosquée Aqsunqur.
Je découvre des signes tracés sur ton corps, noirs sur noir,
une écriture
Qu’ils se sont
appliqués à dissimuler sous les décombres.
Las ! Qu’on dégrade, qu’on arrache, qu’on enchaîne ou
qu’on détruise,
"La vérité
dans l’Homme doit disparaître, la beauté sera factice",
Tels sont leurs commandements, les lois substituées, Malice :
Des lois
barbouillées sur la Vérité qui s’amenuise…
Iblis, satan fourbe, dans le livre, dans chaque Père et
chaque frère…
Écoute :
mes mots de femme sont de lumière.
 |
Otto Pilny - Portrait d'une femme orientale
|
— Quelle femme, en effet.
D’une force troublante…, commenta Jean, admiratif.
— Elle avait tout juste dix-sept
ans ! Depuis deux ans, ses parents tentaient de lui trouver un époux, mais
elle faisait des complications : elle refusait les partis qu’on lui
proposait, et, en dernier lieu, faisait envoyer aux hommes de ces bonnes
familles un poème où elle donnait un piètre portrait d’elle-même, ce qui causait
l’annulation des arrangements. Mais sa famille finit par éventer la ruse. Ils
ne comprenaient pas : chacune des sœurs du quatuor majestueux avait trouvé un parti, sauf elle. Les autres
sœurs attendaient qu’Amira soit mariée pour pouvoir, à leur tour, trouver un
mari. Leurs mères, les autres épouses d’Amir, fulminaient contre Amira. Le
prince Amir décéda sur ces instances, ce qui n’arrangea rien, bien au
contraire. Le nouveau maître, Ahmad, était encore célibataire, et il était
parti à l’étranger remplir son devoir de soldat mamelouk au service des
Ottomans. Ma pauvre maîtresse fut rudoyée par les femmes du Harem. Ainsi
tourmentée par le gynécée, elle admit qu’elle pourrait entrevoir son mariage à
une condition : si seulement elle pouvait emporter dans sa nouvelle
demeure l’eunuque Wadih. Il y eut discussion, mais on lui tendit un piège. Sans
y prendre garde, ma chère Amira, qui maîtrisait pourtant si bien la langue,
admit à mots couverts son amour pour moi. La mère d’Amira, qui était la première
épouse du prince, une femme habile, parvint à étouffer le scandale, mais il s’agit,
dès lors, pour les Al-Razzaz, de se débarrasser de mon outrageuse personne.
 |
| La musicienne - Rudolph Ernst |
— Et voilà, je craignais
ce moment…, soupira Jean Cromar.
— Toute la maison ne
parlait plus que mariage. Il fallait un époux pour Amira et, surtout, une
épouse pour Ahmad. Le palais voisin était occupé par une riche et noble famille
yéménite. Or, il se trouvait que leur fille Khala était promise depuis quelques
années à Ahmad. On fit revenir le prince de la guerre afin de célébrer son
mariage. Cette union accordait les deux maisons en un palais encore plus vaste,
qui ferait la jalousie de tous. À l’occasion de la cérémonie, je pus revoir le
baron Hierosme d’Adaoult. Il avait été invité par le prince Ahmad avec lequel
il avait partagé plusieurs chasses après que les relations avec la France
s’étaient normalisées. Il me reconnut et me rappela quelques émouvants concerts
que nous lui avions donnés, dont le premier, il y avait presque dix ans, dirigé
par Alma, au luth, qu’il conservait précieusement dans son cœur. Il me dit
qu’il aimerait pouvoir entendre de nouveau ma voix. Je lui expliquai ma
situation délicate au sein de la maison et la négligence où nous tenions,
depuis quelques années, l’art du chant. Le baron s’en émut et me promit de
m’aider. Ah, mais je ne savais pas quelle était son intention, sinon je l’aurais
supplié de ne pas m’offrir son aide ! Monsieur le Baron, en effet, offrit
un bon prix à la famille Al-Razzaz pour m’obtenir. On m’emmènerait hors du
Caire, on me séparerait d’Amira, de mes chères maîtresses. J’en pleurais
amèrement... »
Les deux causeurs
avaient fait les quelques pas qui vous font passer de l’anse de l’Ourse à
l’anse de la Joliette. Ils étaient descendus sur la grève. Des enfants jouaient
là, dans une barque échouée. Sur le bassin, un couple d’adolescents grimpé dans
une chaloupe s’entraînait à la godille entre les deux rives de l’anse, se
vantaient l’un l’autre d’être le plus rapide. Un peu au-dessus de la plage, les
fortifications alanguies, éboulées par endroits, surveillaient la scène,
réchauffaient leurs pierres et leur poussière — l’heure de la sieste.
 |
| J-L Gérôme - Prière au Caire |
« Nous n’avons pas
quitté le Caire…, reprit Wadih. Nous logions dans une belle demeure, à une
distance raisonnable de mon ancien palais. Je faisais tout mon possible pour ne
pas céder à la mélancolie. Hors de question que monsieur le Baron eût le
moindre désagrément à me prendre à son service, j’y mettais un point d’honneur.
En outre, le soulagement de ne pas partir favorisait mes engagements. Monsieur
d’Adaoult voulait m’acclimater à la culture française avant le départ, en me
faisant apprendre la langue, d’abord, en m’initiant à la musique européenne
ensuite — il jouait du violoncelle et un de ses amis français au Caire avait
quelques aptitudes au chant. Tous deux essayaient de m’apprendre des airs en
haute-contre, mais je n’aimais pas tenir les notes ainsi qu’ils me le
demandaient et j’improvisais trop de modulations. À tout le moins,
considérant mes larges facultés d’apprentissage, le baron fit de moi le
dépositaire de sa science, de son savoir philosophique et historique, le témoin
de ses découvertes. Pourtant, j’étais loin d’être l’élève modèle : en
musique, où mes habitudes s’avéraient contradictoires avec les attentes
occidentales, et dans certains domaines qui exigeaient la plus stricte discipline
intellectuelle, je m’égarais. Il y eut des moments d’impatience du baron. Sa
violence pouvait être outrancière et grotesque : des trépignements et des
cris, des coups sans force, maladroits. C’était une violence d’homme solitaire,
surtout habitué à s’en prendre à lui-même, sans cruauté. J’aimais cette
autorité empruntée, qui me rappelait celle du vieux Hanine. Je respectais cela,
plus que jadis les coups placés de mon père, bien plus que l’autorité dispensée
au fouet du prince Amir. J’aimais ces colères incontrôlées qui tombaient sur
moi, qui étaient d’incroyables preuves d’amour. Plus monsieur d’Adaoult trépignait,
plus il se couvrait de ridicule, et plus il trouvait un disciple zélé, dévoué —
plus j’apprenais à l’aimer en retour. Monsieur Cromar, vous voyez peut-être ce
que je veux dire… Vous l’avez bien connu, mon maître, non ?
— Oui, c’était un
personnage pittoresque, monsieur le Baron… Une aisance étonnante à se mêler aux
petites gens, à les écouter…
— À les contredire,
aussi. Il pouvait être péremptoire, précisa Wadih.
— Oui, avec son index
haut en l’air, sa façon de marteler ses propos. Mais il regardait toujours de
ton côté, à la fin de ses tirades, pour voir si tu étais d’accord avec lui. Il
me semble qu’il a tenu à toi plus encore qu’à un fils.
— Oh…, fit Wadih, presque
pudique.
— Si tout de même, il t’emmenait
partout à sa suite ! Il se vexait à ta place, quand on lui faisait un
commentaire sur toi…
— Certaines personnes ont
dit… Monsieur Cromar, c’est un peu délicat comme question…
— Je t’en prie…
— Des mauvaises langues
ont dit que monsieur le Baron était amoureux…
— De vous ?, fit
semblant de s’étonner Cromar.
— Cependant… Vous pensez
que ce soit possible ? » Wadih était songeur.
« Je ne sais pas…
J’ai connu beaucoup de personnes différentes. Les gens se charment de choses
très diverses, parfois inattendues. Ce n’est pas impossible…
— Vous trouveriez ça
répugnant ? »
Cromar, hésitait,
farfouillait le sable avec sa chaussure. Wadih reprit la parole :
« Moi, je
trouverais cela inouï. C’était un soleil et je ne suis qu’un pauvre aérostat
gonflé d’air. Alors que j’étais un esclave, un eunuque, un nègre tronqué, il a
veillé à mon accomplissement intellectuel, lui dont tant d’esprits éclairés
eussent désiré les enseignements. Il écoutait avec enchantement les chants
arabes que je connaissais ou inventais, lui qui ne jurait que par Scarlatti,
Pergolèse et Mozart. Il m’aidait à traduire des poésies, lui qui avait côtoyé
Chateaubriand ! Il réclamait mes contes, les plaçait plus haut que les
Mille et une nuits d’Antoine Galland… Je… Monsieur le Baron… sans lui… »
Wadih s’était tu. Les
muscles de son visage se contractaient de chagrin. Jean Cromar posa sa main sur
l’épaule haute et massive. Une pierre claqua près d’eux.
C’était les adolescents
qui avaient fini de ramer entre les bords de la Joliette et ils voulaient se
payer la tête de Wadih ; ils mimaient le singe. Cromar prit un petit galet
et le lança, de biais, droit dans le ventre d’un des garçons.
« Tu diras à ton
père, Charles Gassaud, que Jean Cromar attend paiement de son ardoise à La Calamarette ! »,
semonça-t-il l’adolescent.
Ce soir-là, Cromar
invita Wadih à dîner. On discuta de l’héritage du baron, car Hierosme
d’Adaoult, célibataire et sans famille connue, avait fait de son serviteur
l’héritier principal de sa fortune. Il fut aussi question des regrets de Wadih,
de ses bonnes maîtresses qu’il avait laissées au Caire, de la douleur de se
voir privé de nouvelles, qui équivalait presque à leur mort. On chercha à
établir une différence entre les regrets d’un esclave qui ne fut jamais maître
de son destin, et les regrets d’un homme capable d’exercer son
libre-arbitre ; ces considérations philosophiques occupèrent, sans que la
conclusion réconfortât Wadih, toute la fin de la soirée.
 |
| Etienne Dinet - Le Caire |
Pour ce brave homme,
déjà passé par d’innombrables épreuves, l’année qui s’écoula ensuite fut
éprouvante : les autorités notariales et administratives récusaient le
testament du baron ; Wadih, livré à lui-même, fut exposé à tous les pires
racontars. Cela finit par plusieurs procès qui le laissèrent humilié, sans le
sou et apathique. Il conservait une casemate dans un jardin qu’il entretenait,
hors les murs de la villa abandonnée du baron. Il repassait de temps à autre
voir l’aubergiste, lui donner de ses nouvelles. Quelques clients l’avaient à la
bonne, malgré les commérages qui circulaient sur son compte. Ceux-là
ressassaient les contes orientaux les plus grivois que Wadih leur avait donnés,
sous l’emprise de la boisson. Il leur souriait timidement. Son intelligence le
portait à la rêverie, au détachement. Il errait dans des limbes de plus en plus
aveuglants.
 |
| Rudolph Ernst - La lectrice |
Ainsi, ce fut une
terrible et bouleversante nouvelle quand P’tit Denis vint prévenir Jean Cromar
du drame : deux hommes louches avaient abordé Wadih sur le port ; ils
l’avaient entraîné dans une ruelle et l’avaient poignardé. Ils s’étaient
acharnés sur son corps et l’avaient laissé sans vie, disloqué. Personne ne semblait
connaître qui avait commis ce crime.
L’aubergiste accusa le
coup. Une journée et un soir s’écoulèrent ; il aida au service, s’efforça
de rire aux mauvaises plaisanteries des clients, empocha leur argent ; il
fut d’une excellente cordialité avec Pierrette, sa cuisinière, qu’il
complimenta quatre fois ; puis il embrassa sur le front Armide, sa
serveuse, lui dit paternellement de prendre soin de P’tit Denis, son amoureux.
Ensuite, il découcha dans les bras d’une vieille amie indulgente, mal
accompagné d’une bouteille d’eau-de-vie et de pensées rageuses contre les
humains.