 |
| Riza Abbasi - Jeune garçon à la coupe de vin |
« Est-ce que tu vas
me tuer avec ce couteau ? Je sais que tu me détestes…, dit-elle, le regard
fureteur.
— Mais qu’est-ce que tu
racontes ?
— Tout le monde me déteste…
Ils disent que je suis une pourriediablesse.
— Ah ? »
Je m’apprêtais à lui
prendre la main pour la relever quand elle prit une poignée de sable
poussiéreux et me l’envoya dans les yeux.
« Pourquoi t’as fait
ça ?!, m’écriai-je.
—
Pour
pas que tu me tues ! », ricana-t-elle comme une démente.
Le temps que je me frotte
les yeux et que je reprenne mes esprits, elle se tenait à quelques pas et elle
brandissait fièrement mon poignard.
« Je vais t’égorger,
fit-elle.
—
Pourquoi
tu veux faire ça ?! », m’indignai-je.
Mais, soudain, cette
petite fille ardente s’éteignit : ses épaules s’affaissèrent et se mirent
à s’agiter de sanglots. Elle pleurait dans ses mains sales. J’étais très
vivement impressionné. Elle était si vite passée d’un état à un autre ! Je
m’approchai prudemment. Elle écarta ses mains de son visage ; il était
maculé de sable et de pulpe de pêche.
« Est-ce que tu es
un gentil garçon ?, me demanda-t-elle.
— Ça, par exemple… Hum, je
ne suis pas méchant… », fis-je.
Cette
réponse parut lui suffire. Elle s’avança et me prit d’autorité la main. Je
sentis son contact collant et plein de sable.
Elle
m’entraîna vers le verger où je découvris de nombreux arbres fruitiers. Elle me
montra l’échelle et dit :
« Prends-nous
des pêches. »
En
digne chevalier servant, je ne me fis pas prier, d’autant que j’avais été, dans
leur dispute, lésé de la pêche promise. Grimpé dans l’arbre, je décrochai deux
pêches que je fourrai dans le bas de ma longue chemise. D’une main, je m’accrochais
à l’échelle, l’autre main relevait le pan de tissu autour des fruits.
« Prends-en
plus !, fit Yasmin.
— Attends, je sais pas si
c’est une bonne idée…, dis-je piteusement.
— C’que tu es rabat-joie…,
dit-elle, boudeuse.
— Eh bien t’as qu’à monter
en prendre, toi.
— Non, je vais me faire
gronder. »
Sa réplique me fit
dresser les cheveux sur la nuque. Je n’avais pas du tout l’intention de me
faire gronder à sa place, par des gens chez qui je devais paraître
irréprochable.
« Je descends.
— Prends-en plus !
— Non.
— T’es pas gentil.
— C’est comme ça. »
Je lui tendis une pêche
et conservai l’autre pour moi.
Je marchais derrière
elle, tout en emplissant ma bouche du fruit juteux, dont le goût puissant me
portait droit au paradis.
Nous marchâmes lentement,
silencieux tant que dura notre régalade, vagant dans les allées fleuries.
Au bout d’un moment, nous
parvînmes auprès de la plus grande cage à oiseaux que j’eusse jamais vue de ma
vie. Dans cette cage où une dizaine d’acrobates auraient pu sans peine échafauder
une pyramide humaine, s’ébattaient des quantités d’oiseaux multicolores qui
produisaient un concert formidable de pépiements. Je crus entendre tout à coup
dans ce magma sonore le son étouffé d’un galop de cheval. Je tournai la tête en
tous sens. Yasmin rit et me montra du doigt un oiseau. Tout en haut de la
volière, sur son perchoir royal, se tenait un mainate farceur. C’était lui qui
avait fait cette drôle d’imitation.
« Viens, on rentre
dans la cage, dit Yasmin.
— On a le droit ?
— Non, mais ça fait
rien : c’est seulement Donya qui nous a interdit.
— Et alors ? Vous
n’écoutez pas les conseils de Donya ?
— C’est pas notre mère.
— Si, dis-je. C’est
l’épouse de votre père. C’est pareil.
— Tu es…, fit Yasmin en
levant les yeux au ciel. Tu es chiant. »
Je ne m’attendais plus à
cette agressivité. J’avais baissé ma garde.
« Viens, on rentre.
— Non.
— T’es chiant et… t’es un
peureux.
— Je ne suis pas
peureux. »
Pour lui montrer que la
couardise n’avait pas atteint mon âme, je mis la main sur la porte de la cage.
Yasmin comprit. Elle fit tourner la petite clé dans le loquet, ouvrit la
première porte. Nous entrâmes dans ce vestibule. Elle referma la première porte
puis ouvrit le loquet de la seconde porte.
Alors, nous fûmes au
milieu des oiseaux. Les envols effarouchés autour de nous faisaient des
tourbillons de rouge, de jaune, de vert et de bleu. L’odeur de fiente,
douceâtre, et les fines poussières de plumes me firent tousser. Je levai la
tête et vis la perspective vertigineuse des barreaux se rapprocher jusqu’à la
voûte de la cage.
J’entendis le rire
moqueur de Yasmin et tournai la tête dans sa direction. Elle était ressortie de
la volière ! Elle avait fermé le loquet, puis avait verrouillé d’un tour
de clé la cage à oiseaux.
« Cervelle de
moineau ! Cervelle de moineau !, brailla-t-elle.
—
Attends !
Fais pas ça ! Sors-moi de là, s’il te plaît ! »
Elle me tira la langue et
s’enfuit en courant.
Autour de moi, je sentais
l’affolement frémissant des oiseaux, leur peur de moi et leur colère. Le mainate
fit un scandale : « Fioui ! Pas maintenant ! Pas
maintenant ! » Des gorgebleus coururent autour de moi en poussant des
petits cris féroces ; un bengali rouge fila comme une flèche sous mon nez
en frôlant ma tête ; les trilles des mésanges s’augmentaient, se
réunissaient, s’accumulaient. Le vacarme des oiseaux s’amplifiait toujours,
atteignait une puissance douloureuse et il me semblait qu’ils complotaient
furieusement de m’arracher les cheveux,
puis la peau des mains et du dos, avant de me picorer les yeux. Je me
précipitai sur la porte au loquet et tentai de le crocheter à l’aveugle, mais
je ne parvenais pas à en comprendre le mécanisme et la panique me faisait
perdre mes moyens. « Au secours ! Au secours ! »
Après quelques instants,
ma panique finit par refluer, les oiseaux retrouvèrent aussi leur calme.
J’appelai de nouveau à l’aide et je vis alors Zarrin émerger d’une allée et se
diriger tranquillement vers moi.
Elle ouvrit la première
porte de la cage et s’approcha. Elle mit sa figure contre la seconde porte
grillagée et, formant un cône de ses mains, me fit signe de bien tendre
l’oreille. J’approchai ma figure de la sienne et elle me dit en
chuchotant :
« Eh bien, pauvre
Ali Abed… Je te sortirai de là si tu me montres ton oiseau. »
Je me reculai, surpris ;
je ne saisissais pas bien l’objet de sa requête. Je réfléchis un temps puis je
crus comprendre qu’elle mettait à l’épreuve mon sens esthétique. J’essayai
d’imaginer quel pouvait bien être, parmi tous les spécimens de la cage, celui
qu’elle affectionnait le plus. Enfin, avisant l’oiseau le plus extravagant — un
long corps vert et bleu, avec quelques plumes noires mordorées et un bec jaune
vif, une houppette rouge —, je le montrai du doigt et dis :
« Celui-ci ! »
Zarrin fit éclater un
rire strident. Elle riait tellement qu’elle s’accrochait aux barreaux pour ne
pas tomber. Des larmes perlaient à ses yeux. Entre deux hoquets, elle me
dit :
« Eh bien, quel
prétentieux ! »
Alors, avisant un tout petit
oiseau noir qui chantait merveilleusement, je repris :
« Attends ! À
dire vrai, je crois que c’est plutôt celui-ci ! »
Elle fut si surprise de
ma répartie que ses yeux s’agrandirent démesurément. Puis elle s’effondra,
suffoquée par le rire.
« Voilà… C’est…
déjà… plus… réaliste… »
Elle finit par se
remettre debout. Je n’étais toujours pas sorti de ma prison. Elle refit le même
geste d’approcher mon oreille. Je m’exécutai comme un bon garçon.
« Je voulais parler
de ton oiseau, celui qui chante quand tu lui fais souffler de l’eau dans une
mare ou dans les buissons… »
Cette fois, après
quelques instants de doute, je finis par comprendre la bizarre allusion. À
Yazd, avec mes amis, nous désignions cette partie de notre anatomie par le mot
courant doul ou par le mot plus enfantin :
doudoul. Jamais nous n’aurions eu
recours au genre d’image invraisemblable employé par ma cousine. Mais
maintenant que j’avais déchiffré son langage, je ne comprenais pas mieux :
pourquoi voulait-elle voir ça ? Ce n’est pas une chose très intéressante…
« Tu veux vraiment
voir mon doul ? », dis-je.
Elle s’écarta
brusquement, choquée, la main sur la bouche. Elle fit cependant un signe
affirmatif.
« Bon… Ça n’a
pourtant rien d’extraordinaire… »
Je dénouai ma ceinture,
baissai mon pantalon, puis remontai ma longue chemise.
Zarrin demeura interdite,
ses yeux détaillant mon anatomie. Je me sentis très gêné d’une telle curiosité.
Je remontai brusquement mon pantalon.
« Pourquoi
voulais-tu voir mon… oiseau ?, fis-je.
—
Mais…
parce que nous, les filles… On n’a rien. »
Voilà qui me coupa le
sifflet.
Je requis :
« Et maintenant, je
t’ai montré ce que tu voulais… Tu veux bien me laisser sortir ? »
Elle me délivra.
« Ma sœur est une pourriediablesse, dit-elle. Je vais le
dire à Donya, que ma soeur t’a enfermé dans la volière. Tu vas voir : elle
va se faire bien laver et bien frotter ! Ah ! »
Je la suivais qui
marchait d’un pas décidé vers le palais de ses parents. Je sentais la
délivrance approcher : devant les adultes, mes cousines ne se
permettraient plus ce comportement violent qui me mettait au supplice.
« Donya va battre
Yasmine à cause de moi ?, m’inquiétai-je.
— Non… Donya est faible.
Mais elle dira certainement à père ce que ma sœur a fait, et alors… la petite
goûtera de la badine ! Hahaha !
— Mais ce n’est pas grave…
Je… J’ai même pas eu peur.
— Ha ! Et si des
oiseaux étaient morts de terreur, hein ? Ils ne te connaissaient
pas ! Ils ont dû paniquer ! Des oiseaux si rares ! Et quel
malheur s’ils étaient morts ! Ha ! Tu peux être sûr, la petite pourriediablesse va se faire bien
battre… »
Elle
jubilait à l’idée du supplice que recevrait sa petite sœur… Son refrain de
satisfaction, son sourire mauvais me révoltaient. Je ne comprenais pas d’où
venait leur violence.
« Où
est votre maman ?, dis-je.
— Dans un trou.
— Oh, elle est montée au
paradis ?
— Moi, je l’ai vue dans un
trou, sous une grande pierre.
— Alors, si elle était
bonne, elle est montée au ciel.
— Ils l’ont lavée et bien
lavée et frottée, d’un côté puis de l’autre. Puis ils l’ont entourée plein de
fois dans du tissu, puis on l’a mise dans un trou… »
Pendant
que Zarrin me racontait cela, sa peau avait changé de couleur ; elle avait
pris des teintes de glaise et s’était couverte de fines gouttelettes de sueur.
Je n’osais plus rien dire.
« La
pourriediablesse va se faire bien
laver et bien frotter… »
Elle
serrait les dents, en proie à une colère d’une violence inouïe.
Mais
Yasmine nous coupa la route.
« Va-t’en !,
dit Zarrin.
— Qu’est-ce que vous
faites ?, fit Yasmine.
— On rentre à la maison, je
vais dire que tu as enfermé Ali Abed dans la volière… Tu seras fouettée !
— Si tu dis ça, je dirai
qu’il t’a montré son oiseau… C’est vous qui serez fouettés ! »
Mon cœur sombra dans une
terreur folle. Je ne serais pas fouetté, je serais écorché vif !
Zarrin,
elle, demeura quelques instants interdite. Trop intéressée par ce dont elle
pouvait profiter de moi, elle n’avait pas songé que sa sœur eût pu se cacher
pour nous espionner.
— Pourriediablesse ! Pourriediablesse !,
hurla-t-elle, impuissante.
— Tu pourras rien dire,
sinon je me vengerai ! Et même, tu pourras plus jamais ! Maintenant,
ce sera toi la diablesse ! »
Je n’étais plus si pressé
de retourner vers les adultes. Il fallait que mes deux cousines se réconcilient
car je risquais d’y laisser ma peau. Je fus le plus parfait hypocrite : je
dis que je m’étais drôlement bien amusé avec elles et que leurs jeux, s’ils m’avaient
fait un peu peur, m’avaient aussi fait sourire intérieurement. Je fis toutes
sortes de compliments sur leurs caractères qui n’étaient pas les caractères
timides des filles de Yazd. Il me semble même que je croyais un peu à mes éloges
galants. Nous pûmes jouer un peu tous les trois autour d’un bassin, à plonger
nos pieds et à échanger de menues moqueries – je me laissais faire.
Je me laissais faire, ce
qui les réjouissait, les accordait sur mon compte. Elles me pinçaient, me
tiraient les cheveux. Yasmine me mordit le bras. Je me laissais faire, et j’avais
dans le cœur un mélange de colère et d’abandon lascif.
Quand vint midi et que nous
fûmes parvenus devant le grand hall à colonnades du palais, mes cousines se
tenaient de chaque côté de moi, leurs visages avaient abandonné toute méchanceté,
toute sournoiserie, et je portais mon regard incrédule de l’une à
l’autre : elles composaient des mines sérieuses, indéchiffrables ;
leurs visages portaient encore, affadie, cette lointaine lueur de malice ;
j’étais encore un peu fâché contre elles, mais qu’elles me paraissaient
belles ! — comme après l’orage la nature humide et rafraîchie, odorante et
mobile, éclaboussée des rais de lumière qui percent les nuages, toute emplie
d’une mystérieuse présence…
Personne ne fut grondé, j’avais
agi en grand diplomate auprès de ces deux furies. Les adultes ne surent rien
des disputes, de l’enfermement dans la volière et encore moins de la curiosité
de Zarrin.
Le reste de la journée
fut par ailleurs très ennuyeux, très protocolaire. Mon oncle recevait chez lui
des courtisans et quelques marchands notables d’Ispahan. On me fit manger le
déjeuner avec les hommes, parmi lesquels figuraient quelques grands garçons
très sûrs d’eux. On échangea des ragots sur la vie de cour qui ne parvinrent
pas à me passionner car je n’en connaissais pas les protagonistes. On fit de
longs discours sur les besoins et nécessités de la ville et de ses alentours,
sur les routes sûres et celles qu’il fallait rendre plus sûres. Les voix se
firent dramatiques quand on évoqua l’empire et ses frontières… Mon professeur,
mêlé à cette cour d’hommes, se montrait à la fois obséquieux et détaché. Je
sentais que tout cela ne l’intéressait que modérément. Le repas s’éternisa une
grande partie de l’après-midi.
Pendant tout ce temps, je
me demandais ce que faisaient mes cousines. Mon corps était encore plein de
douleur et de colère. Mais mon esprit, suavement, considérait leurs gestes
souples et brusques, leurs voix abruptes, accusatrices, leurs visages énigmatiques
et l’intérêt bizarre qu’elles me portaient...
Le soir vint.
Au moment de partir, je
revis Donya, la belle épouse de mon cousin vizir. Elle était triste de me
quitter.
« J’espère que nos
filles ne t’ont pas embêté…, me dit-elle.
— Non, madame, mentis-je.
— Je ne sais pas comment
m’y prendre avec elles. Je ne parviens pas à les gronder, même lorsqu’elles
font les pires bêtises. J’essaie même de les protéger des châtiments physiques…
pourtant, elles ne remercient jamais. Oh, Ali Abed, toi, tu as l’air différent
de tous les enfants que je connais. Si Dieu, Loué soit-il !, le veut bien,
j’aimerais tant qu’il me donne un fils comme toi…
— Madame, sur mon âme
peinée de ce départ, vos compliments apportent le réconfort comme les bonnes
pêches juteuses de votre verger. »
Donya
me prit dans ses bras et son corps parfumé me transmit une tendresse que je
n’ai jamais oubliée.
Elle
me dit :
« Ressens-tu
le poids de ce que je t’ai donné ? Je le sens retranché de mon corps, il
s’est ajouté à toi. Désormais, mes pensées t’accompagnent, gentil Ali
Abed. »
Puis
elle me donna une feuille sur laquelle elle avait rédigé un poème.
Devant
la madrasa Soltani où je m’apprêtais à m’instruire une année entière, mon
esprit était obsédé de deux choses : le poème composé pour moi par Donya
et l’étrange matinée que j’avais passée avec mes cousines. J’étais presque
indifférent aux apprentissages qui m’attendaient, à peine soucieux à l’idée que
je devrais rencontrer de nouveaux maîtres, certainement plus sévères. Donya
m’écrivait ceci :
Ali Abed aux yeux de cerf
Contemple le monde avec patience ;
Sa pensée sonde les
mystères ;
Je veux retrouver l’innocence !
L’enfant grandit,
deviendra homme.
Il forcira, durcira, son regard s’étrécira comme
Les épées fines et
coupantes, mais… je t’en supplie,
Que ce cœur-là reste le même et qu’il plie
Devant l’énergie des
filles et la douceur des mères,
Oh ! Qu’Ali Abed demeure le songeur aux calmes paupières.
Je
peux dire que ce poème de Donya s’inscrivit en moi et que désormais je fus
l’enfant le plus doux, le plus patient, le plus curieux aussi. Je reçus à la
madrasa Soltani les bases d’une éducation musulmane classique ; mais je tempérais toujours ce que les maîtres
disaient sur la vicieuse brûlure des femmes à la fraîcheur du poème de Donya.
J’étais un élève si brillant que Khorshid écrivit à mes parents pour requérir
l’autorisation de me scolariser indéfiniment à Ispahan.
Les
années passaient, je m’instruisais. Mon envie de savoir semblait inextinguible.
Je crois que j’épuisais les mollahs.
Parfois,
je retournais brièvement à Yazd. J’y retrouvais des amis, des cousins. Mais,
hormis Abed Salem, dont j’ai fait mention plus tôt, mes liens d’affection
s’atténuaient. Mon père et ma mère espéraient faire de moi un prestigieux khan
de Yazd. Ils regrettaient que je m’intéresse plus à la théologie et aux
sciences qu’à l’étude de la loi…
Je
revis mes cousines Zarrin et Yasmine, mais je n’eus plus le loisir de souffrir
leur agressive pétulance car, avec l’âge, nous étions sans cesse entourés
d’adultes, et bientôt d’ailleurs je n’eus plus le droit de les fréquenter.
On
fit épouser, à l’âge de quatorze ans, Zarrin au jeune fils d’un autre vizir du
Shah. Yasmine fut mariée un peu plus tard, à treize ans, avec un homme plus
âgé, mais celui-ci ne supporta pas la mariée davantage que la première nuit de
noces : il la répudia triplement dès le lendemain.
Ma petite cousine était
désormais, de notoriété publique, une jeune femme indésirable.
Après quelque temps,
Donya prit contact avec ma mère et échafauda de me proposer d’épouser Yasmine.
Considérant la réputation de Yasmine, mes parents n’y étaient pas vraiment
favorables, mais ils voyaient d’un bon œil le rapprochement avec cette branche
puissante de notre famille. Quant à moi, je ne pouvais pas résister à une si
grande requête de Donya.
Le mariage se fit.
Maintenant, je ne sais
si je dois l’avouer avec honte… Il m’est arrivé, il m’arrive encore de me faire
un peu battre par mon extravagante épouse. Pour autant, je crois que chaque
coup que mon échine a reçu était mérité. Jamais Yasmine ne me frappe sans
raison. Quant à moi, je ne la frappe pas. J’aime ses taquineries, j’aime son
regard dénué de l’hypocrisie si commune en ce monde.
Je suis le nouveau
gouverneur de Yazd. Mes savoirs philosophiques et techniques me sont très profitables.
Je continue à composer des poèmes et je me suis attelé à la maîtrise de la
peinture. Les notables de Yazd disent que Yasmine me domine, mais ils devraient
plutôt lui en savoir gré, car qui sait quelles cruautés j’ai enfouies dans mon
cœur, qui peut savoir toutes les horreurs que mon imagination aurait pu me
faire réaliser, qui peut savoir qui j’aurais pu être, dans d’autres
circonstances, avec d’autres guides ?
Un jour, peut-être,
j’ouvrirai à ces sires cauteleux, à ces marchands égoïstes et à tous les
fourbes médisants de Yazd mon cabinet de peinture, et ils verront, en
miniature, toute la violence, toute la cruauté que j’ai, à force de volonté,
détachée de mon âme. Ils verront que la férocité, la brutalité d’Ali Abed Khan
aurait pu égaler celles de nos plus illustres tyrans : Timour Leng et
Gengis Khan.
Et je clos ces mémoires
en vous livrant le conte très impressionnant que Yasmine me fit lors de notre
première nuit de noces :
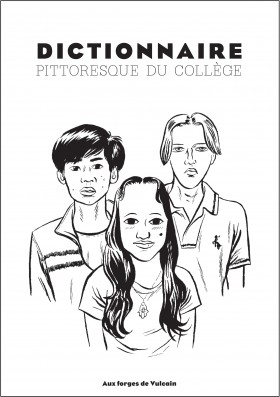


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire