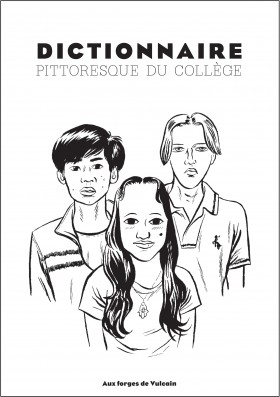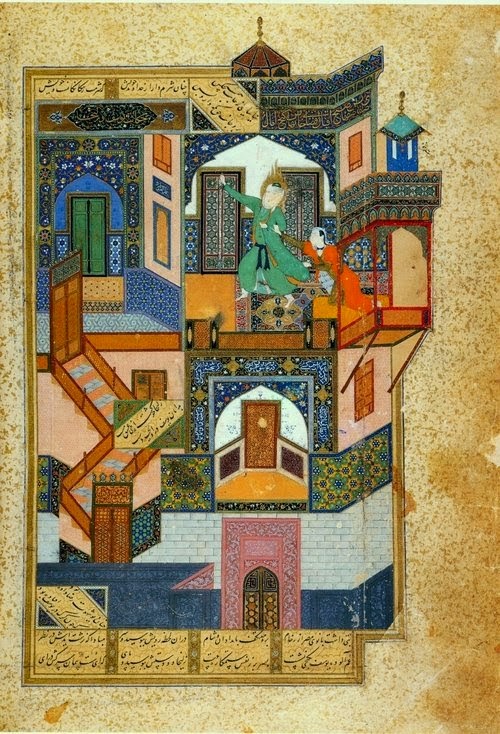Nous errâmes toute la matinée en quête de quelque
chose de tendre pour la pointe de mon poignard. En vain.
Au temps de midi, nous dévorâmes un plat de
lentilles chez Behrouz, un riche marchand, un ami de ma famille. La question de
mon poignard trouva son chemin dans la conversation.
« Veux-tu, mon cher
Ali Abed, que je t’offre un agneau ?, dit le marchand. Tu pourrais le
sacrifier dans la cour, chez tes parents, mon esclave pourrait t’assister. Je
serais honoré de faire ce don à ta famille.
— Qu’en dis-tu ?,
soutint Khorshid, mon professeur, les mains jointes contre ses lèvres en signe
de concentration (signe que je devais bien réfléchir à ma réponse).
— Cette proposition
m’oblige, monsieur, dis-je à mon hôte. Vous êtes bien aussi généreux et fiable que
mes parents le disent. Mais mon désir d’utiliser mon poignard n’est pas animé
par la pensée d’un sacrifice.
— Pourtant, objecta le
marchand, offrir un sacrifice à Allah est un acte tout à fait noble et digne
pour ce poignard.
— Cela est vrai, Behrouz.
Mais… Je veux avant tout trouver à ce poignard un usage qui m’instruise sur ce
que je suis ou sur ce que je veux être.
— Que voilà un petit garçon
bien enseigné !, s’enthousiasma-t-il. Tu dois avoir un professeur
remarquable. », dit Behrouz avec un clin d’œil appuyé à mon précepteur.
Nous
reprîmes ensuite notre errance dans la ville et ses alentours, ponctuée par les
prières à la mosquée.
L’après-midi était très chaude et nous fûmes
accueillis par de nombreux amis de ma famille et de mon professeur. Tous
avaient leur mot à dire sur le poignard et sur l’utilisation qu’ils en auraient
fait.
En fin de compte, nous rencontrâmes un de mes
cousins, Abed Salem, un garçon un peu plus âgé que moi pour lequel j’ai
toujours eu un profond respect. Il me montra son propre poignard et me dit
qu’il avait longuement réfléchi au problème, lui-aussi, et qu’il ne lui avait
jamais trouvé de meilleur usage que l’acte de tailler ou graver le bois, qu’il
s’agissait de trouver le bois tendre et l’offrir au fer tranchant et qu’ainsi
s’accomplissait l’un des désirs de Dieu : que l’homme soumette et transforme
la nature.
« Que dis-tu de cela ?, fit mon
précepteur. Veux-tu que nous allions chez le marchand chercher une bonne
tablette de bois, pour ton couteau ? »
Je fus un peu dépité de cette proposition, mais
je pris le temps d’y bien réfléchir. J’étais épuisé par mon imagination
héroïque et guerrière ; je n’avais cessé d’envisager une bête ou un homme
forcené attaquant un petit enfant ou une faible grand-mère, et qui eût alors
mérité un coup vengeur de ma part. Je désirais porter un simple coup d’estoc
dans la chair d’un agresseur, pour interrompre une injustice. Peut-être
rêvais-je de la gloire éclatante des héros du Shah Nameh, Le Livre des Rois,
comme Rostam, le plus fort de tous, qui parvint à tuer l’immortel Isfandiar en
lui blessant les deux yeux d’une seule flèche à double pointe, ou comme
Fereydoun qui terrassa le roi-serpent Zahhak et l’enchaîna au mont Damāvand ?
Mais, si je prolongeais ma pensée, que se
passerait-il une fois porté dans la chair le coup de poignard ? La plaie saignerait ;
mon odieux ennemi agoniserait, il aurait des râles douloureux, il m’attraperait
par la chemise et me supplierait de l’aider ; il me couvrirait de son sang
fluide, chaud et collant… Décidément, Allah n’avait que trop bien écouté ma
prière : il m’envoyait de nouveau d’horribles visions…
Finalement, éreinté par ces images morbide, je
dis : « Oui… Je serais enchanté de trouver une tablette de bon bois
et d’essayer mon poignard sur elle. »
Le professeur fit pour mon compte les louanges
d’Allah ; ma réponse l’avait mis de bonne humeur.
Nous nous procurâmes donc une petite planche de
tilleul que je choisis avec soin.
« Que veux-tu y
graver ?, demanda mon professeur.
— Mon nom, dis-je.
— Le nom d’Allah pouvait
être une meilleure réponse, mais ce n’était pas le but de notre
journée… », dit mon professeur en souriant pour lui-même.
Et il me montra comment m’y prendre avec le
poignard pour réaliser des lettres dans le bois. Ce n’était pas facile de
maîtriser le sillon, de creuser sans fendre, de suivre l’arrondi des lettres,
de conserver de bonnes proportions dans la calligraphie. Je m’appliquai, dans
la relative fraîcheur de l’ombre du patio de mes parents. Khorshid commentait
longuement mon prénom :
« Ali, le très haut, et Abed, le serviteur… C’est une invitation à
l’humilité et, en même temps, à la conscience d’une très haute dignité,
vois-tu, Ali Abed ? Tu es d’une famille de Khans, qui sont en de nombreux
lieux les maîtres du territoire, et on t’a donné le prénom le plus fiable qui
soit, le prénom de celui qui saura servir avec le plus de tact, le plus
d’esprit, celui en qui on aura confiance, le meilleur conseiller. Tu es le
garant d’un ordre des choses, au sommet du royaume. C’est un prénom qui
pourrait convenir à un grand vizir. Mais serviteur
peut aussi signifier serviteur d’Allah,
ainsi Ali Abed peut également être un nom d’imam ou de roi. Applique-toi bien
sur la calligraphie de ton prénom, car la beauté, la noblesse des lettres que
tu graves est le reflet de ta détermination à être le véritable Ali
Abed… »
Je terminai à la lueur de quelques bougies que je
me fis porter. Je soufflai sur les copeaux, je ponçai le bois en refaisant tout
le tracé des lettres, puis admirai mon ouvrage.
« Du premier coup, tu as réalisé un travail
splendide. », fit mon maître.
Le lendemain, nous présentâmes à mon père et à ma
mère la tablette sur laquelle j’avais gravé mon nom. Mon précepteur fit le
récit de notre journée. Mon père s’enthousiasma, il se répandit en
remerciements à Dieu et me félicita très chaleureusement. Puis il dit que le
temps était peut-être déjà venu de me présenter à la cour, à Ispahan.
Les adultes firent ensuite des discours où ils tressaient
à l’avance mes futurs succès, ces paroles enflaient mon orgueil et mettaient au
supplice ma timidité. Mon professeur renchérissait sur la fierté qu’il tirerait
de mon éducation devant ses collègues savants d’Ispahan… »
« Qu’est-ce que vous
en pensez ?, s’interrompit soudain Bibi-Gol. Ce n’est que la première
partie de ce que je voulais vous raconter.
— Mmh… J’aime bien ce petit
Ali Abed, dit Arach. Il est sensible…
— Ça me plaît, dis-je de
mon côté.
— J’ai ajouté quelques
petites choses au texte original, dit Bibi-Gol. Par exemple, la description de
Yazd depuis le désert n’est pas faite dans le texte que j’ai recopié. L’auteur
dit « Yazd » et pense que son lecteur sait à quoi ressemble la ville.
Initialement, ce récit a attiré mon attention, parce qu’il ressemble presque à
un conte.
— Oui, convint Arach. L’histoire
du poignard, objet symbolique qui initie une mise à l’épreuve du héros. Sous
forme de conte, on verrait bien une journée où Ali Abed rencontrerait
successivement le rat pollueur, le chien brutal, puis un assassin sans
scrupules. Trois rencontres. Il débarrasserait la ville du rat et des maladies,
pour le soulagement du peuple. Puis il ferait la peau du chien au grand bonheur
des marchands. Enfin, il rencontrerait
l’assassin qu’il tiendrait en respect grâce à son poignard, au moment où
celui-ci s’apprête à tuer la princesse locale. Après cela, il obtiendrait la
main de la princesse...
— Ali Abed a neuf ans…,
rappelai-je mon ami à la réalité.
— Oui, mais d’ailleurs je préfère
cette histoire vraie. Et tu as la suite, Bibi-Gol aimée ?, interrogea
Arach.
— Oh oui, et ça va te
plaire, mon cher Arach. Je vais sauter encore quelques pages, pour en venir au
moment où Ali Abed, quelques mois plus tard, se rend à Ispahan chez le cousin
de son père, accompagné par Khorshid, son professeur.